
Rudy Loock
- FACULTE DES LANGUES, CULTURE ET SOCIETES
Présentation
Agrégé d’anglais
Professeur des Universités section 11, département des Langues Étrangères Appliquées (LEA), Faculté des Langues, Cultures, Sociétés (LCS)
Linguistique, Traductologie (langues de travail : anglais-français)
Représentant de la formation TSM au sein du réseau European Master's in Translation (EMT) de la Direction générale de la traduction de la Commission européenne
Responsable du blog MasterTSM@Lille (ISSN-2534-5885)
Thématiques de recherche :
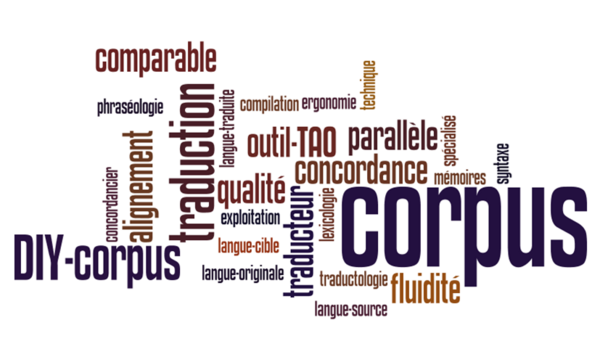
Traductologie (traductologie de corpus, enseignement de la traduction, traduction automatique)
A l’heure actuelle, je mène activement des recherches en traduction/traductologie, que j’aborde d’un point de vue linguistique. Après avoir dans un premier travaillé sur la traduction de la langue non standard, à savoir la façon dont doit s’envisager la traduction de structures ou d'une orthographe qui dévient de la norme prescriptive (dictionnaires, grammaires) mais utilisées sciemment par des auteurs de fiction afin de définir linguistiquement leurs personnages, et sur la traduction de la forme, à savoir la traduction d’agencements syntaxiques donnés comme sens/information supplémentaire au sens logico-sémantique, mes recherches se situent aujourd'hui dans le cadre de la traductologie de corpus et de la didactique de la traduction outillée (traduction automatique notamment).
Intrigué par une problématique d’ordre pédagogique, j’ai souhaité mener une réflexion plus globale sur la façon dont l’usage linguistique peut/doit être quantifié, au moyen de corpus comparables ou parallèles, et pris en compte lors de l’activité traduisante. Ces activités de recherche, qui se situent dans le cadre de ce que j'ai nommé en français la traductologie de corpus (corpus-based translation studies), visent à étudier, au-delà des différences inter-langagières, les différences intra-langagières entre langue traduite et langue non-traduite, en essayant notamment de déterminer ce qui relèverait des "tendances universelles" en traduction et de l'interférence de la langue source. Un autre objectif est de vérifier s'il existe un lien entre ces différences linguistiques entre langue originale et langue traduite d'une part et la qualité d'une traduction d'autre part, au travers notamment de l'analyse de corpus d'apprenants compilés dans le cadre du projet. Parallèlement, je travaille sur la façon dont les corpus électroniques, comparables et parallèles, peuvent être utilisés en dehors des logiciels de TAO comme outils d’aide à la traduction (aide à la prise de décision, résolution de problèmes de traduction, compilation de glossaires monolingues et bilingues). Ces recherches trouvent leur application en didactique de la traduction puisqu'elles se veulent porteuses en termes de pédagogie (mise au jour de différences inter-langagières, observation de la langue traduite) grâce à des expérimentations auprès des étudiants du parcours de master TSM (Traduction spécialisée multilingue) de l'Université de Lille.
Mes travaux de recherche récents s’intéressent à la traduction automatique. Selon la même méthodologie que pour la mise au jour des différences entre langue originale et langue traduite (par des professionnels ou des étudiants), l’objectif est de mettre au jour ce que l’on a appelé le machine-translationese, à savoir les spécificités linguistiques des textes produits par la machine. L’objectif final reste le même : déterminer les écarts vis-à-vis des normes attendues, et par conséquent les phénomènes à surveiller dans le cadre de la post-édition. Parallèlement, je m'intéresse à la façon dont les outils de traduction automatique peuvent s'intégrer dans la formation, des futurs traducteurs mais aussi des étudiants en langue(s) (niveau licence) dans le cadre des cours de traduction ou autres, selon une approche raisonnée et professionnelle. Ceci concerne à la fois les traducteurs en ligne (DeepL, Google Traduction, Reverso, eTranslation) mais aussi les Large Language Models (LLM) du type ChatGPT, Deepseek, ou LeChat. Depuis 2020, je coordonne un travail de réflexion sur la façon dont il est possible de former les étudiants en langue à l'utilisation des traducteurs en ligne, grâce à la mise au jour de leurs pratiques réelles et de l'évaluation de leur capacité à repérer et à corriger les erreurs de la machine et avec pour objectif final le développement d'une nouvelle compétence numérique, la "MT literacy" pour reprendre un terme de Bowker & Buitrago Ciro (2019). L'objectif est de développer une formation, théorique et pratique, afin d'adoptée une approche raisonnée des traducteurs en ligne et des LLM, non seulement pour la traduction mais aussi pour d'autres tâches (extraction terminologique notamment).
Avec le même objectif, un projet en cours s'intéresse à la pertinence de la distinction entre la post-édition (correction de traductions automatiques) et la révision (correction de traductions humaines).
Pragmatique du discours
Mes recherches dans ce domaine (2001-2012) se sont articulées autour d’une structure syntaxique particulière, à savoir la PROPOSITION SUBORDONNEE RELATIVE APPOSITIVE, par opposition à la proposition subordonnée relative déterminative selon une opposition devenue traditionnelle, au sein de la langue anglaise. Dans le cadre de ma thèse, j’ai souhaité me placer du côté de la pragmatique du discours afin de dégager les fonctions discursives remplies par cette structure syntaxique, traditionnellement définie en « creux » par rapport à la relative déterminative. Je me suis ainsi placé dans la lignée de linguistes comme Lambrecht, Birner ou Ward, qui attribuent une fonction précise au choix d’une structure syntaxique dans le cadre de l’organisation du discours, établissant de ce fait un pont entre syntaxe d’une part et discours d’autre part. En particulier, je me suis intéressé au statut informationnel des contenus véhiculés, selon la distinction opérée par Prince (1981, 1992) entre information nouvelle/ancienne du point de vue du discours et information nouvelle/ancienne du point de vue des connaissances partagées. A partir d’énoncés toujours contextualisés, j’ai proposé une taxonomie selon la fonction remplie par la relative appositive en discours. Afin de compléter cette définition, j’ai également proposé, dans le cadre de la théorie de l’information packaging (cf. Vallduvi 1992, 1993), de comparer la relative appositive à d’autres structures syntaxiques remplissant des fonctions discursives proches, telles que la proposition parenthétique, la proposition indépendante juxtaposée ou coordonnée, ou l’apposition nominale. J’ai alors proposé toute une série de paramètres régissant le choix de l’énonciateur de véhiculer un contenu informationnel donné par une relative appositive ou une de ses structures concurrentes, que j’ai nommées « allostructures », terme dérivé du terme anglais allosentences créé par Daneš (1976). Mon travail, basé sur une approche multi-registres, a donc porté tant sur la communication écrite que sur la communication orale, en particulier spontanée. Ce travail sur l’oral m’a alors permis de mettre au jour un emploi particulier du pronom relatif dans le cadre de la communication orale spontanée au sein de propositions relatives sortant des schémas syntaxiques traditionnels. Après la thèse, divers prolongements ont eu lieu, toujours suivant le même axe de recherche. Ainsi, un approfondissement de la recherche des contraintes régissant le choix entre la relative appositive et ses allostructures, a permis de mettre au jour certains phénomènes comme le "fame effect" ou encore la fausse hiérarchisation à visée de politesse. En particulier, un projet de recherche en collaboration avec Cyril Auran (site du projet ici) a permis d'établir une corrélation entre phénomènes discursifs et marquage prosodique. Un ouvrage publié en 2010 chez John Benjamins rassemble et synthétise l'ensemble de ces recherches menées de 2000 à 2010.
Mon attention se porte également sur ce que j'ai nommé l'"antéposition attitude" en langue française, à savoir les structures du type N+N, à ordre régressif (grève attitude, job salon, guerre académie).
J'ai également participé, dans le cadre du projet PFC (Phonologie du Français Contemporain), à une étude et à l'écriture d'un chapitre sur le français parlé dans le nord de la France.
Mes recherches dans le cadre de la pragmatique du discours m'ont également améné à m'interroger sur le choix des données et la sécurisation des jugements d'acceptabilité pragmatique, en particulier au moyen de comptages de fréquences à partir de données issues du web et au moyen de la technique de la Magnitude Estimation. Ma note de synthèse d'Habilitation à Diriger des Recherches a été consacrée à ces deux sujets.
Dernières publications
-
MT or not MT? Do translation specialists know a machine-translated text when they see one? 20th Machine Translation Summit, Jun 2025, Genève, Switzerland. pp.442-454. Avec Nathalie Moulard et Quentin Pacinella.
-
Intégrer plutôt qu'interdire : retour d'expérience sur l'utilisation des traducteurs en ligne et des LLM pour enseigner la traduction en licence LEA Epilogos, 2025. Avec Benjamin Holt.
-
Enseigner la compilation et l’exploitation de corpus monolingues spécialisés pour la traduction : retour sur expériences et suggestions. ILCEA 57, 2025.
-
L’agence virtuelle de traduction au sein de l’université : Le cas du TSM Skills Lab de l’Université de Lille. Al-Zaum, Malek ; Medhat-Lecocq, Héba ; Negga, Delombera. Former des traducteurs et des interprètes, Editions des archives contemporaines, collection Plidam, pp.163-174, 2025.
-
3 enseignements, 2 intervenants, 1 texte hyperspécialisé à traduire : présentation d’un travail terminologique effectué en opérant un décloisonnement pédagogique avec des étudiants en traduction. Syn-Thèses - Revue annuelle du Département de Langue et de Littérature Françaises de l'Université Aristote de Thessalonique , 2025, 16. Avec Nathalie Moulard.
-
Augmented Linguistic Analysis Skills: Machine Translation and Generative AI as Pedagogical Aids for Analyzing Complex English Compounds. Technology in Language Teaching & Learning, 2024, 6 (3), pp.1-27. Avec Benjamin Holt.
-
Translation and Interpreting. In Wendy Ayres-Bennett and Mairi McLaughlin. Oxford Handbook of the French Language, Chapter 21, Oxford University Press, pp.569-592, 2024. Avec Nicolas Froeliger



