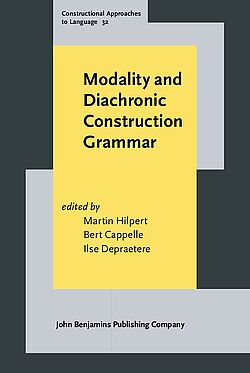Bert Cappelle
- FACULTE DES LANGUES, CULTURE ET SOCIETES
Présentation
Bonjour !
Je suis professeur des universités en linguistique anglaise. En tant que chercheur, j'aime observer l'usage des mots en contexte. Dans la lignée de la grammaire de construction cognitive basée sur l’usage, je défends l'idée qu'une grande partie de notre connaissance linguistique repose sur des exemplaires. Autrement dit, notre grammaire se construit progressivement, de manière ascendante. À partir des énoncés concrets auxquels nous sommes exposés, nous détectons peu à peu des séquences récurrentes et en extrayons des schémas plus abstraits. Ainsi, les patrons schématiques (les constructions au sens traditionnel) coexistent avec plusieurs des séquences lexicales qui les ont fait émerger, au sein d'un vaste espace mental de stockage que nous appelons le construct-i-con.
Vous pouvez suivre mes recherches sur ResearchGate ou Academia, où vous trouverez des liens vers le texte intégral de la plupart de mes publications.
J’ai exploré plusieurs problématiques au fil des ans ; la page Axes de recherche en propose un aperçu.
Si vous êtes étudiant et que vous souhaitez savoir sur quels sujets vous pourriez travailler pour votre mémoire de master ou votre thèse de doctorat, consultez également la page Enseignements.
Ouvrages récents
Recension de cet ouvrage par Jakob Horsch dans English Language and Linguistics.
Recensions de cet ouvrage par Marta Carrareto dans English Language and Linguistics, par Yubin Qian sur SSRN et par Ziheng Zhou et Deliang Wang dans Corpus Pragmatics.
Et alors ?
Le travail des linguistes—et surtout celui des linguistes descriptifs et théoriciens—est-il vraiment important ?
C’est une question légitime.
L’intelligence artificielle générative actuelle, fondée sur des modèles de langage de grande taille (LLMs), n’a pas été développée par des linguistes, mais principalement par des ingénieurs et des informaticiens. Pourtant, le succès de systèmes comme ChatGPT, Claude, Gemini, etc., soutient certaines des théories linguistiques les plus récentes, celles qui mettent l’accent sur l’émergence à partir des données et rejettent une syntaxe innée. En effet, les capacités surprenantes de l’IA générative utilisant des LLMs semblent s’aligner plus naturellement avec les approches basées sur l’usage et probabilistes et avec la nature interactive de l'apprentissage humain des langues, qu’avec la vision de la grammaire universelle (GU). Le fait que les chatbots d’IA contemporaine puissent converser avec une telle facilité apparente—produisant et interprétant des énoncés nouveaux avec une syntaxe complexe de manière sémantiquement subtile et pragmatiquement appropriée—suggère que la connaissance du langage peut émerger de l’exposition, façonnée par la fréquence et pare une expérience enracinée dans le social, plutôt que d’un module inné régi par des règles rigides et explicites. Ainsi, certains linguistes avaient raison. Mais ils n’ont pas été consultés. Et ils n’ont pas été crédités.
En toute honnêteté, une grande partie de ce que nous faisons en tant que linguistes est, avant tout, d’intérêt pour les linguistes eux-mêmes, certains d’entre eux étant concentrés sur le développement de théories adéquates sur la manière dont les mots sont intégrés dans des constructions, comment ces constructions sont liées à d’autres constructions et ce que sont les constructions, en premier lieu. Ce sont, il est vrai, des préoccupations plutôt académiques, et à part peut-être pour l'enseignement des langues, nous ne savons pas avec certitude si des applications pratiques découleront jamais de certaines des idées théoriques que nous formulons.
Cependant, il arrive que des linguistes soient explicitement appelés en tant qu’experts pour aider à trancher des questions ayant une portée au-delà des campus universitaires. J’ai moi-même eu l’opportunité récemment de fournir mon expertise dans une affaire d’arbitrage international, aux côtés de quatre autres linguistes, sur le sens précis des mots dans une phrase d’un traité d’investissement bilatéral, dont l’interprétation semblait sujette à débat. Les différends liés aux investissements entre États et entreprises peuvent avoir des enjeux financiers élevés, atteignant parfois plusieurs centaines de millions de dollars—voire plus de dix milliards de dollars. Lorsqu’il s’agit d’États expropriant des biens sans compensation juste (ou sans compensation du tout), les linguistes peuvent ainsi apporter une contribution précieuse en veillant à ce que les accords juridiques soient interprétés avec précision. Une fois les ambiguïtés réelles ou apparentes clarifiées, ces accords peuvent être correctement appliqués, ce qui peut contribuer à promouvoir une société plus juste et équitable.
Mais il est vrai que nous ne sauvons pas directement des vies.
Ou est-ce le cas ?
Prenons par exemple la violence armée. Aux États-Unis seulement, plus de 10 000 personnes sont assassinées chaque année avec des armes à feu. Chaque fois qu’une protestation contre la violence armée aux États-Unis a lieu, les groupes favorables aux armes invoquent le deuxième amendement, qui protège « the right of the people to keep and bear arms ». Cependant, en utilisant des techniques standard de la linguistique de corpus, il peut être soutenu que les rédacteurs de la Constitution avaient probablement l’intention de se référer au droit collectif de servir dans des milices, plutôt qu’au droit individuel de posséder des armes. Ce n’est qu’un exemple de la manière dont une analyse de l’usage ordinaire des mots et expressions dans leur contexte (historique) a un impact de vie ou de mort.
Il en va de même en diplomatie, où les enjeux sont souvent bien plus élevés. Une formulation inadéquate peut exonérer les organisations internationales de l’exercice de leurs devoirs moraux. Par exemple, lorsque les organisations s’abstiennent d’appeler les atrocités de masse « génocide » et utilisent plutôt l’expression « actes de génocide », elles créent l’illusion d’un crime moins grave, bien que, linguistiquement, « actes de génocide » ne devrait signifier rien d’autre que génocide et constituer ainsi des crimes contre l’humanité—tout comme des « actes de vandalisme » sont simplement du vandalisme et donc des délits punissables. Les linguistes pourraient donc non seulement aider à garantir que la communication reste suffisamment vague et non-confrontationnelle mais aussi, dans d’autres cas, exposer les formulations nuancées qui dissimulent une réalité plus brutale. Et parfois, il revient aux linguistes d’appeler un mensonge un mensonge.
La linguistique ne prend peut-être pas souvent le devant de la scène dans le discours public, mais sa pertinence va bien au-delà de ce que beaucoup réalisent. Alors, le travail des linguistes est-il vraiment important ? Les preuves parlent d’elles-mêmes. La linguistique, aussi lorsqu’elle est de nature théorique ou descriptive, peut faire gagner du temps et remporter des contentieux cruciaux et pourrait parfois même sauver des vies.