
Elodie Lecuppre-Desjardin
Axes de recherche
Capturing the Present in Northwestern Europe (1348-1648). A Cultural History of Present Before the Age of Presentism
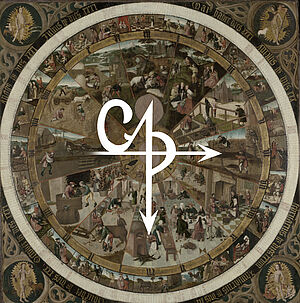
Saisir le présent dans l’Europe du Nord-Ouest (1348-1648). Une histoire culturelle du présent avant l’âge du présentisme. Projet lauréat d'un FNS-SINERGIA 2024-2028
(PI : Elodie Lecuppre-Desjardin (U LIlle), Thalia Brero (Université de Neuchâtel), Jan Blanc & Estelle Doudet (Université de Lausanne). Collaboratrice scientifique : Marije Osnabrugge (Université de Lausanne).
Ce projet de recherche explore la manière dont le concept de « présent » a été perçu et vécu en Europe du Nord-Ouest durant la période allant du Moyen Âge à la première modernité. Cet espace géographique, qui englobe les Pays-Bas, l’ouest de l’Empire germanique, le nord de la France et le sud de l’Angleterre, a connu durant cette période d’importants changements, aussi bien dans les domaines de la politique, de l’économie, de la religion, que dans celui de l’art. Caractérisée par la coexistence de divers systèmes politiques et de plusieurs langues, un développement urbain particulièrement marqué et des conditions de vie à l’évolution rapide, cette région incarne un contexte historique singulier, qui diffère de la Renaissance telle qu’elle est traditionnellement dépeinte.
Notre démarche se veut exhaustive et interdisciplinaire, en réunissant histoire, histoire de l’art et de la littérature, linguistique, media studies, anthropologie et sciences politiques. Trois principaux axes de réflexion retiendront particulièrement notre attention : retracer l’évolution du concept de « présent » de 1348 à 1648 ; révéler à cet égard les caractéristiques culturelles propres à l’Europe du Nord-Ouest ; examiner comment les individus et les communautés auxquelles ils appartenaient percevaient la notion de présent et s’y adaptaient. Nos analyses viseront à montrer comment les discours et les images ont façonné les perceptions (individuelles et collectives) que les hommes et les femmes d’alors avaient de leur propre époque ; comment les événements contemporains étaient représentés et interprétés ; comment, enfin, les nouvelles idées ainsi que les changements politiques et sociétaux étaient perçus.
En redirigeant la focale historique vers le Nord-Ouest de l’Europe, ce projet de recherche entend mettre en lumière la diversité et la complexité de cette aire culturelle, tout comme le rôle essentiel qu’elle a joué en influençant la perception du présent dans un contexte européen plus large.
L'université de Lille orientera la recherche sur le présent comme impératif d'action en politique à l'échelle de la ville, de l'Etat et de l'Empire.
Communication politique et histoire de la construction étatique à la fin du Moyen Âge

Les recherches sur les idéologies politiques, les techniques de propagande, la circulation des bruits, la place du symbolique dans les discours des princes et de leurs sujets, les moteurs de l’action gouvernementale… sont au cœur de mes travaux depuis de nombreuses années. Dans mon dernier livre, Le royaume inachevé des ducs de Bourgogne (Belin, 2016), j’ai pu avancer des idées neuves permettant de réinterroger la notion d’ « Etat bourguignon », pour, dans une histoire à hauteur d’homme, privilégier l’expression plus neutre de « Grande Principauté de Bourgogne ». Aujourd’hui cette vaste enquête se poursuit dans le cadre du programme Cultures politiques quotidiennes porté par Christopher Fletcher et grâce au projet D’Auffay que je dirige en collaboration avec Jonathan Dumont (Université de liège) et les Archives départementales du Nord, afin d’éditer le manuscrit du Mémoire de Jean d’Auffay destiné à défendre les droits de Marie de Bourgogne contre les prétentions du roi de France (1477-1478)
https://irhis.univ-lille.fr/recherche/programmes-de-recherche/programmes-en-cours/dauffay/
Monde des villes et villes du monde (1300-1500)

Spécialiste d'histoire urbaine et de la Flandre médiévale, j'oriente actuellement mes recherches vers une histoire comparée empruntant aux pistes suggérées par la world history.
Lorsque Julien Gracq confie les sentiments que Nantes, où il a vécu une partie de sa jeunesse, lui inspire, révélant le rôle de la ville sur ses rêveries et la livrant à son imaginaire, l’écrivain dans La forme d’une ville, a ponctuellement recours à un système de comparaisons, de métaphores, d’analogies qui progressivement donnent forme à la ville. Rapprochée tour à tour de Porto, Caen, Rochefort, Rio, Amsterdam, Stuttgart, Quimper, etc. Nantes s’installe dans un paysage, se façonne, prend du relief, se dote d’une âme dans ces pages où les mots de l’auteur et leur appareillage deviennent la structure d’un urbanisme et d’une urbanité installés dans l’esprit du lecteur par les jeux de l’écriture. Mais comment passer de la forme d’une ville à la forme de la ville ? C’est autour de cette question de l’essence urbaine et grâce à l’histoire comparée que deux projets sont en préparation. L’un concerne l’édition commentée du Journal de Voyage de l’anonyme milanais (v. 1516-1518), l’autre aboutira à un essai sur les villes du monde entre 1300 et 1500.



